Faut-il éviter de voir les choses de manière trop simpliste ?
Question d'origine :
Est-ce-que c'est vrai qu'il ne faut pas voir les choses 'en tout noir ou tout blanc' -la réalité, le monde, la vie, les choses sont très compliquées-et il faut donc éviter de voir les choses de manière simpliste 'en tout noir ou tout blanc'?
Réponse du Guichet
Voir les choses ou toutes noires ou toutes blanches relève de la pensée manichéenne, ou pensée polarisée elle-même découlant de distorsions cognitives. Il serait préférable d'adopter un raisonnement plus rationnel.
Bonjour,
Vous souhaitez savoir s'il est vrai qu'il ne faut pas voir les choses tout en tout noir ou tout blanc, de manière simpliste.
Comme souvent dans nos réponses à vos questions, nous ne saurions vous dire ce qui est vrai ou pas car d'une part, à l'instar de tout être humain, nous ne détenons pas la vérité, d'autre part la vérité est une notion complexe que nous avons déjà abordée dans au moins une dizaine de vos questions dont,
- Connaitrons-nous un jour toutes les vérités ?,
- La philosophie et la science sont elles plus fiables que les autres domaines d'études ?,
- Les philosophes ne sont-ils donc jamais d'accord ?,
- Est-il vrai qu'il est tout à fait légitime de se poser des questions ?
- Est-ce que l'on peut penser que finalement il n'y a pas de grande vérité ?
- Est ce que chacun peut croire ce qu'il veut ?
Nous ne pourrons donc pas affirmer ou infirmer qu'il ne faut pas voir les choses tout en tout noir ou tout blanc, de manière simpliste.
Par ailleurs, vous posez votre question en utilisant une injonction il ne faut pas. Là encore, pour couvrir tous les termes de votre questionnement, il serait juste de réfléchir à la notion d'obéissance. Ceci nous amènerait bien trop loin du sujet principal que vous souhaitez voir abordé, voir les choses tout en tout noir ou tout blanc, de manière simpliste. Mais sur l'obéissance vous pourriez écouter cette émission de France culture, Faut-il apprendre à obéir ou à désobéir ? et lire ces articles, La liberté consiste-t-elle à n’obéir à personne ?, Philosophie magazine, Spinoza et le problème de l’obéissance / Pierre Macherey, Hypothèses, Liberté de l'obéissance selon Thomas d'Aquin / Camille de Belloy, HAL.
Que signifie voir les choses tout en tout noir ou tout blanc, de manière simpliste ?
L'article du Figaro Sciences intitulé Pourquoi pensons-nous le monde en noir et blanc ? va nous donner un point de départ. Il explique que cette façon de penser relève du manichéisme. Pour le CNRTL, le manichéisme est l'attitude de celui, de celle qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal. En religion et en philosophie, c'est une doctrine religieuse conçue par Mani, fondée sur la coexistence et l'antagonisme de deux principes cosmiques égaux et éternels : le bien et le mal ; conception qui admet le dualisme antagoniste d'un principe du bien et d'un principe du mal.
«Le terme “manichéen” provient d’une religion zoroastrienne du IIIe siècle, guidée par le Perse Mani, qui affirmait que tout n’est que conflit entre lumière et ténèbres , explique Richard Monvoisin, chercheur spécialiste de l’étude des théories controversées. On dit ainsi qu’est manichéenne une façon de raisonner lorsqu’elle réduit artificiellement une discussion à deux alternatives contradictoires.»
Source : Pourquoi pensons-nous le monde en noir et blanc ?, Le Figaro Sciences, 07/08/2020
En psychologie, toujours selon le CNRTL, le Manichéisme délirant est un délire décrit par Dide et Guiraud, dans lequel le malade voit le monde divisé en deux fractions qui s'affrontent à son sujet et assiste à cet affrontement sans y participer (d'apr. Pel. Psych. 1976).
L'article du Figaro explique que
quand elles interrogent cette tendance à adopter ce type de pensée en noir et blanc, les psychologies cognitives et sociales parlent de «pensée polarisée» ou de «polarisation» des attitudes, des sentiments et des croyances, qui nous conduisent à nous ranger à des positions parfois extrêmes. Pour le chercheur en psychologie sociale Sylvain Delouvée, l’analyse doit se faire à deux niveaux : l’individuel et le collectif.
Voyons de plus près ce qu'est une pensée polarisée avec l'article La pensée polarisée, une distorsion cognitive du site NosPensées dans lequel il est aussi expliqué les raisons pour lesquelles cette distorsion cognitive fait son apparition et comment surmonter les difficultés qui nous amènent à raisonner ainsi :
La pensée polarisée est une distorsion cognitive. Cela signifie qu’il s’agit d’une erreur de raisonnement que nous commettons sans nous en rendre compte. Nous traitons de manière erronée l’information que la réalité nous fournit ce qui nous pousse à expérimenter un certain niveau de perturbation émotionnelle.
Les distorsions cognitives ont été décrites par Albert Ellis et Aaron Beck. En général, on les définit comme des croyances erronées qui créent un état moral dysfonctionnel. Des peurs irrationnelles ou une tristesse sans fondement en sont des exemples. La pensée polarisée correspond à l’une de ces modalités de la distorsion cognitive.
Ce qui se cache derrière la pensée polarisée est en fait une simplification extrême de la réalité. Les choses sont blanches ou noires, positives ou négatives, etc. En adoptant ce type de point de vue, nous sommes incapables d’identifier les nuances qui existent entre un extrême et un autre. A quoi est dû ce phénomène ? Comment surmonter cette vision ? Approfondissons.
Les caractéristiques de la pensée polarisée
La principale caractéristique du raisonnement dichotomique est la tendance à généraliser et à regrouper les différentes réalités dans une seule et unique catégorie. Pour cette raison, les mots favoris des individus qui pensent ainsi sont les termes catégoriques suivants : toujours, jamais, tout, rien, etc. Ils en font usage de manière automatique. Ils doivent mettre l’ensemble des événements isolés qui se présentent à eux dans des cases.
Ce qui est préoccupant, c’est que ces catégories extrêmes sont généralement très négatives. Ils en font usage pour évoquer l’existence de quelque chose de mauvais. Ils font un usage courant d’expressions telles que “Je rate tout ce que j’entreprends“, “Tout le monde finit par profiter de moi“, ou d’autres raisonnements du même type.
Pour ceux qui adoptent un raisonnement dichotomique, c’est comme s’il n’existait aucune nuance ou aucun point intermédiaire. Ils construisent une bonne partie de leur identité sur des classifications contondantes et ils cherchent à tout positionner ainsi. Bien que la réalité ne leur démontre leur erreur, ils résistent et ne souhaitent pas abandonner leur radicalisation.
Dans le résumé de l'article Les distorsions cognitives, ces processus de pensées qui entretiennent la rigidité de nos représentations de A. Sabatier, dans L. Souche 10 films pour comprendre la psychologie cognitive (p. 69-76). In Press. (2023), il est indiqué que les distorsions cognitives agissent en filtre sur la réalité pour assurer une cohérence psychique et une stabilité interne alors même que la rigidité du schéma génère souffrance et processus de répétition.
Toujours d'après l'article du Figaro, au niveau individuel
on pourra évoquer les travaux de Daniel Kahneman où il définit deux systèmes de pensée» explique le chercheur. Le système 1 est le système de la pensée intuitive, de la pensée simple et automatique. Nous l’utilisons dans la vie de tous les jours afin de ne pas dépenser trop de réserves cognitives ; «mais c’est la pensée la plus biaisée, signale Sylvain Delouvée. Comme je ne réfléchis pas ou le moins possible, j’utilise des stéréotypes et des biais cognitifs qui me permettent de simplifier le monde pour pouvoir répondre facilement et vite. Ce système n’est pas toujours faux mais il conduit le plus souvent à des erreurs.» Le système 2 est celui de l’analyse consciente et de la pensée rationnelle. Elles demandent davantage de ressources cognitives, car on doit réfléchir et ne pas utiliser de raccourcis de pensée.
et au niveau collectif
la dimension motivationelle, relative au groupe : «La polarisation de la pensée est en lien avec l’identité sociale et l’appartenance au groupe», explique Sylvain Delouvée. «Lorsque mon groupe est menacé, je pense de manière simplifiée pour renforcer la cohésion, pour faire bloc. Je stigmatise ceux qui ne font pas partie du groupe afin de ne pas perdre identité de celui-ci. Cette identité peut-être politique, religieuse, idéologique…»
Ce second niveau explique pourquoi les communautarismes et les mouvances identitaires se sont accentués ces dernières années au point que, selon l'article Edinger, A., Bollen, J., Makse, HA et al. Les distorsions cognitives sont associées à une polarisation politique croissante. Commun Psychol 3 , 105 (2025), cette polarisation est devenue politique :
La polarisation politique s'est intensifiée au cours de la dernière décennie au point de menacer notre autonomie et nos institutions démocratiques. Les schémas de pensée qui la caractérisent présentent une ressemblance frappante avec les distorsions cognitives, un mode de pensée associé à des troubles internalisés tels que la dépression et l'anxiété. Les personnes atteintes de ces troubles ont tendance à se percevoir, ainsi que les autres, de manière exagérée, absolutiste et manichéenne, ce qui correspond aux caractéristiques psychosociales de la polarisation politique.
Nous vous conseillons la lecture de cet autre article, Mohamed Amine Belka, Tara De Condappa, Thibault Renard. Psychologie de la désinformation : approche croisée entre cognition individuelle et influence sociale. 2025. ⟨hal-05188779⟩ résumé aisni :
Dans un contexte où l’information circule en continu et de manière souvent désordonnée, comprendre les mécanismes psychologiques qui favorisent la désinformation s’impose comme un enjeu central. Ce travail s’est attaché à analyser comment certains processus cognitifs et sociaux modèlent la manière dont les individus perçoivent, interprètent, mais aussi relaient des contenus trompeurs. Les biais cognitifs, qu’il s’agisse du biais de confirmation, de l’ancrage, de la disponibilité ou encore de l’effet de simple exposition, viennent perturber la capacité de raisonnement analytique en favorisant des jugements rapides, intuitifs, mais parfois erronés. À ces prismes mentaux s’ajoutent les fragilités de la mémoire, qui, loin d’être un réservoir fidèle, se révèle malléable et sujette aux distorsions : effet de vérité illusoire, faux souvenirs… autant de facteurs qui participent à l’enracinement de croyances inexactes. Les émotions jouent également un rôle clé dans cette dynamique. Peur, anxiété, indignation morale : autant de leviers affectifs qui amplifient la crédulité et accélèrent la circulation des messages, surtout dans des contextes marqués par l’incertitude ou la crise. Mais l’adhésion aux récits manipulés ne se construit pas seulement sur des biais individuels. Elle s’enracine aussi dans des dynamiques collectives : pression normative, autorité perçue, polarisation des opinions… Autant de mécanismes sociaux qui renforcent l’acceptation de certaines idées au sein des groupes. L’ancrage identitaire, associé à la dissonance cognitive, éclaire pourquoi les faits ne suffisent pas toujours à ébranler des croyances, surtout lorsqu’elles sont partagées et valorisées par le collectif. Enfin, il convient de rappeler le rôle décisif des minorités actives, capables, par leur cohérence, leur persévérance et leur stratégie de communication, d’influencer significativement l’opinion publique, parfois au détriment de la majorité passive. En croisant les apports de la psychologie cognitive et sociale, cette analyse souligne combien il est nécessaire de dépasser les approches purement correctives. Renforcer l’esprit critique, développer une culture du doute raisonné, encourager la réflexivité et promouvoir une véritable éducation aux médias apparaissent comme des leviers essentiels pour limiter l’impact de la désinformation sur nos sociétés.
Dans ces visions manichéennes dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, le wokisme peut apparaître comme l'une d'elles. Vous pourriez lire à ce sujet :
- Brice Couturier: «La gauche woke est manichéenne, intolérante et avide de censure», Le FigaroVox, 01/10/2021
- Désintox. « Wokisme », fausse menace mais vraie recette, L'Humanité, 06/11/2021
mais aussi des livres que nous vous indiquons à la fin de cette courte bibliographie sur le manichéisme :
Sortir du manichéisme : des roses et du chocolat / Martine Storti, 2016
Pamphlet qui refuse les affrontements dogmatiques et les oppositions binaires au profit d'une réhabilitation de l'émancipation et d'un retour au collectif pour penser le présent. L'auteure axe sa réflexion autour de quatre problématiques : l'identité nationale, le féminisme, le débat sur le genre et l'antagonisme entre société et sociétal. © Electre 2016
Le manichéisme / Michel Tardieu,..., 1981, Que sais-je ?
Origines religieuses du manichéisme
Mani et la tradition manichéenne / François Decret, 2005
Ce livre rend justice à Mani, à la tradition manichéenne et à sa haute spiritualité. Il rappelle les lieux et le contexte de la naissance de Mani dans l'Iran du IIIe siècle apr. J.-C., où le mazdéisme était la religion officielle, où le christianisme s'implantait, où le gnosticisme gagnait de nombreux adeptes. Le manichéisme est tributaire de toutes ces influences. C'est pourtant une doctrine originale qu'apporte la révélation du " prophète " ou du " seigneur " Mani, mis à mort dans de terribles supplices par le Roi des rois Bahrâm ler, en 277 de notre ère. Textes à l'appui, F. Décret analyse avec précision les éléments de cette doctrine chrétienne dualiste, une spiritualité surprenante et profonde, attachée à résoudre le problème du Mal, et dont on comprend mieux la séduction. Il décrit aussi la vie des premières communautés manichéennes et raconte leur destin ultérieur, dans les terres chrétiennes et musulmanes, mais aussi en Orient et en Chine.
Contre la doctrine de Mani / Alexandre de Lycopolis ; [trad. du grec] par André Villey, 1985
Le plus ancien traité anti-manichéen connu, oeuvre d'un platonicien soucieux de ramener à la raison ses élèves séduits par les émissaires de la religion nouvelle. © Electre
Wokisme
La panique woke : anatomie d'une offensive réactionnaire / Alex Mahoudeau, 2022
Originellement le terme woke est associé aux luttes anti-raciales des Afro-Américains et revêt un sens positif. Il est aujourd'hui utilisé de façon péjorative pour attaquer toutes les formes d'engagement contre les discriminations. Connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Pandov Strochnis, l'auteur explique comment répondre aux attaques réactionnaires. © Electre 2022
Woke / Bart De Wever, 2023
Pamphlet dénonçant les excès du wokisme, que l'auteur assimile à une guerre d'autodestruction menée par une partie de l'élite intellectuelle contre la société occidentale moderne. Face au manichéisme inhérent à ce mouvement, qui réduirait les individus à une condition de victime ou de bourreau, il plaide pour une pensée progressiste, sans culpabilité ni pénitence, favorisant la cohésion. © Electre 2023
Face à l'obscurantisme woke / sous la direction d'Emmanuelle Hénin, Xavier-Laurent Salvador et Pierre Vermeren, 2025
Réflexions pluridisciplinaires sur la progression d'idéologies religieuses, politiques et marchandes dans les milieux scientifiques. En analysant les conséquences du wokisme sur les sciences, les contributeurs montrent comment une telle idéologie favorise le délitement de la vérité et de la rationalité. © Electre 2025
Faut-il avoir peur du wokisme ? : Comprendre la philosophie woke / Romuald Sciora, 2023
Théorie du genre, privilège blanc, intersectionnalité, écriture inclusive, cancel culture... Tous ces concepts et expressions sont régulièrement mis dans le même sac, moqués et caricaturés par une certaine intelligentsia conservatrice française qui ne fait pas économie de mauvaise foi, voire de désinformation, lorsqu'il s'agit de rejeter pêle-mêle toute idée dite « woke ».
Mais concrètement, qu'est-ce que le wokisme ? Dans un style clair, Romuald Sciora répond ici avec rigueur mais aussi avec humour à l'ensemble des questions que la plupart d'entre nous se pose face à un mouvement sociétal sans équivalent depuis la révolution sexuelle des années 1970.
De ses racines à ses plus grands succès, comme la libération de la parole des femmes avec #MeToo, ce livre stimulant nous explique les grandes idées du wokisme. Idées qui, finalement, n'ont pas d'autre but que de contribuer à plus de justice sociale et de tolérance.
Un essai intelligent et objectif dans un océan de malhonnêteté intellectuelle, ainsi qu'une invitation à réfléchir et à remettre en question quelques lieux communs, mais également nos propres préjugés. © 4e de couverture
Soyons woke : plaidoyer pour les bons sentiments / Pierre Tevanian, 2025
Au spectre du « wokisme » qu'agitent de manière désormais obsessionnelle toutes les sphères de la Réaction, qu'elles soient d'extrême droite ou simplement « républicaines », ce livre se propose d'accorder une franche et chaleureuse hospitalité. En plus d'un implacable travail de debunkage, de critique et de généalogie du réquisitoire antiwokiste, il prend le parti d'assumer franchement le stigmate, et même de le revendiquer. Au-delà donc d'une posture strictement défensive, faisant valoir à juste titre que « le wokisme » n'existe pas en tant que courant homogène, puissant et organisé, Pierre Tevanian investit en positif la question, en clamant haut et fort que si ledit wokisme n'existe pas, ou pas encore, ou pas beaucoup, alors il faut l'inventer ! © 4e de couverture
Bonne journée



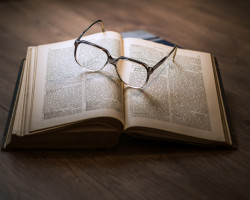
 Estime de soi et fin du monde
Estime de soi et fin du monde