Génétique, partie codante et non codante d'un chromosome
SCIENCES ET TECHNIQUES
+ DE 2 ANS
Le 24/02/2013 à 07h37
223 vues
Question d'origine :
Bonjour,
On sait que les noyaux de toutes les cellules comportent exactement la même information génétique. De plus, on sait que l'ADN est composé de partie codantes (les exons) et de parties non-codantes (les introns), et que toutes les cellules ne produisent pas les même protéines. C'est pourquoi je me pose la question suivante : les parties non codantes d'un chromosome dans une cellule A sont-elles les parties codantes de ce même chromosome dans une cellule B ?
Réponse du Guichet
Le 27/02/2013 à 13h17
Bonjour,
Je ne comprends pas le sens de votre question !
Car si l’on reprend la définition d’un chromosome, on lit cela :
Un chromosome est un élément microscopique constitué de molécules d'ADN et de protéines. Il est l'élément porteur de l'information génétique. Les chromosomes contiennent les gènes et permettent leur distribution égale dans les deux cellules filles lors de la division cellulaire.
Le nombre de chromosomes par cellule est une caractéristique d'espèce.
Chaque cellule humaine contient 2 copies de chacun des chromosomes, l'une héritée de la mère et l'autre du père. Ces deux chromosomes forment une paire de chromosomes homologues. La seule paire qui ne soit pas homologue est celle des chromosomes sexuels.
Malgré les progrès réalisés par les techniques d'imagerie et d'analyse biochimique, la structure du chromosome métaphasique reste dans une large mesure inconnue. Une partie de la difficulté qu'il y a à comprendre son architecture est liée au fait qu'il s'agit d'une structure dynamique, transitoire, qui nécessite donc d'être bloquée à un moment précis pour être analysée. Mais dans le même temps où l'on fige un chromosome par une technique d'analyse, on prend le risque d'en modifier la structure.
Le nombre et l'aspect général des chromosomes sont caractéristiques de chaque espèce, et sont donc identiques chez tous les individus d'une espèce donnée. Il existe cependant certaines régions dont la morphologie peut présenter des variations de taille non pathologiques, appelés polymorphismes. Ces variations sont liées à la présence de séquences répétées en nombre variable, non codantes, ce qui explique l'absence de retentissement clinique. En dehors de ces zones polymorphes, les régions d'ADN répété non codant qui forment l'hétérochromatine constitutive se retrouvent également au niveau des centromères de tous les chromosomes.
Les chromosomes sont constitués en proportions à peu près équivalentes d'ADN, de protéines histones et de protéines non histones. In vivo, l'ADN n'est en effet pas libre dans le noyau mais associé à diverses protéines pour former la chromatine. Celle-ci va s'organiser en structures secondaires et tertiaires pour aboutir à une compaction variable au cours du cycle cellulaire, moins importante pendant l'interphase pour permettre la transcription des gènes et maximale pendant la mitose pour faciliter la séparation des deux lots chromosomiques.
(Extrait de Ultrastructure du chromosome)
Petits rappels :
Une cellule contient entre 30 000 et 40 000 gènes. Cependant elle fabrique au moins trois fois plus de protéines
Dans le noyau d'une cellule, un gène est transcrit par une enzyme, l'ARN polymérase, en un ARN prémessager, qui est une succession d'exons codants et d'introns non codants. Lors de l'épissage et selon le contexte cellulaire, les introns sont éliminés et les exons juxtaposés dans l'ARN messager mature. Celui ci sort du noyau et est traduit par les ribosomes en une protéine.
La définition d'un intron a due être élargie et relativisée avec la découverte d'un autre phénomène. La définition usuelle d'un intron provient de l'observation de son élimination dans le processus de transcription. Or de cette observation, on peut seulement déduire que l'intron n'est pas employé à ce moment, et non qu'il ne sert à rien en permanence.
Observer son inactivité à ce moment ne signifie pas qu'il n'a aucune fonction à un autre moment. De même un intron qui ne joue pas de rôle dans la production d'une protéine, peut en jouer un dans d'autres circonstances.
C'est le cas lorsque le gène se met à coder pour une autre protéine. Contrairement à ce que l'on croyait, on s'est aperçu que les gènes pouvaient coder la fabrication de plusieurs protéines, en induisant la transcription de plusieurs ARN messagers. Au départ, l'ARN transcrit est l'empreinte fidèle du gène (le pré-ARN), mais ensuite, selon le choix des segments qui sont éliminés par excision lors de l'épissage, il peut donner divers ARN messagers. Un certain épissage conduit à un type d'ARN et à la protéine correspondante, et d'autres épissages conduisent à d'autres protéines. On appelle cela l'épissage alternatif.
Or si un intron est éliminé au cours de la synthèse de la protéine 1, mais pas au cours de celle des protéines 2 ou 3, cela signifie qu'il est un exon pour les protéines 2 ou 3. Un intron n'est pas un intron en soi, mais seulement en rapport avec la production d'une protéine donnée.
Pour aller plus loin :
- -L'essentiel de la biologie cellulaire
- Biochimie génétique biologie moléculaire
- Un même gène pour plusieurs protéines, par Fabien Schweighoffer.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



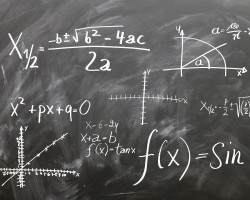
 Le roman de terroir, ou la mauvaise réputation
Le roman de terroir, ou la mauvaise réputation