Question d'origine :
bonjour
pouvez vous me conseiller parmi les nombreuses traductions existantes du grand ecrivain russe svp ?
merci
Réponse du Guichet
Le 14/10/2019 à 08h29
Bonjour,
Les différences notables entre les différentes traductions de Dostoïevski sont bien résumées dans un article de Marie-Christine Blais pour le journal canadien La Presse :
« Quand l'écrivain et traducteur André Markowicz décide de traduire à son tour Crime et châtiment de Dostoïevski en 1996, pour Actes Sud, sait-il qu'il va bouleverser le monde de la traduction littéraire? Jusque-là, c'est la traduction d'«école française» qui menait : on adaptait le texte dans une autre langue, mais en le tirant vers la culture de cette langue de traduction, quitte à embellir l'original ou à transformer le style de l'auteur, pour que la version soit plus fluide pour les lecteurs.
L'«école allemande» propose plutôt de respecter à la fois la langue et la culture d'origine du texte original, de ne pas chercher à «améliorer» le style de l'auteur, quitte à ce que le résultat soit moins élégant, l'élégance étant de toute façon une notion subjective. Les traductions de Markowicz «rendent» le style plus brutal, plus contemporain et moderne de Dostoïevski, près d'un siècle après la mort du grand auteur russe.
Version de Pierre Pascal (traduction à la française)
«Cette pauvre Élisabeth était à ce point simple, abattue et épouvantée une fois pour toutes que l'idée ne lui vint même pas de lever les bras pour défendre son visage, bien que ce fût le geste le plus naturel à cet instant, puisque la hache était levée droit sur sa tête. [...] Le coup tomba droit sur le crâne, du côté du tranchant, et coupa en deux toute la partie supérieure du front presque jusqu'au sommet du crâne. Elle s'écroula.»
Version d'André Markowicz (traduction à l'allemande)
«Et, cette malheureuse Lizaveta, elle était tellement simple, tellement écrasée, à tout jamais terrorisée, qu'elle ne leva même pas la main pour se protéger le visage, même si c'était là, à cet instant, le geste le plus naturel et le plus indispensable, parce que la hache était levée tout droit devant son visage. [...] Le coup lui arriva directement sur le crâne, avec le tranchant de la lame, et lui fendit tout de suite la partie supérieure du front, presque jusqu'au sommet. Elle s'effondra net.» »
Sans vouloir introduire une hiérarchie entre les traductions, on peut résumer ainsi la situation : choisir entre une traduction « à l’allemande » et une traduction « à la française » - autrement dit entre la traduction d’André Markowicz et toutes les précédentes – c’est choisir entre deux expériences : soit découvrir le texte de la façon la plus proche possible de celle d’un russophone, soit le découvrir comme l’ont découvert les lecteurs français de 1880 ou 1930. Un article de Jean-Louis Backès dans La Revue des deux mondes remarque :
« Que s'est-il passé au cours du XXe siècle ? Deux phénomènes sont à considérer. D'abord, des linguistes, non contents de prescrire le bon usage, ont étudié objectivement la pratique langagière des Français, de ceux qui parlent bien comme de ceux qui parlent mal. Certains d'entre eux ont conclu, non sans hyperbole peut-être, à l'existence de deux systèmes différents, distingués notamment par leur syntaxe. Par ailleurs, des écrivains ont donné asile, dans leurs livres, à la variante non académique du français, sans toujours se rendre compte qu'il n'était pas uniquement question de vocabulaire : il ne suffit pas d'enchâsser un mot vulgaire dans une phrase à la Bossuet ; et l'on peut fort bien transcrire le français tel qu'il se parle sans recourir à un seul mot vulgaire.
Cette évolution a-t-elle été favorable à Dostoïevski ? On peut répondre tranquillement par l'affirmative. On le peut, si l'on compare ce qu'était l'état du russe au XIXe siècle et celui du français à la même époque. Sans contredit, la situation actuelle de notre langue est plus proche de ce qu'était alors celle du russe. Dostoïevski est incontestablement l'un des écrivains qui ont joué le plus librement de cet instrument dont il disposait : une langue où aucune discontinuité rédhibitoire n'éloignait la langue académique des manières de parler considérées comme familières, voire populaires. Il était possible de glisser de l'une aux autres par une série infinie d'intermédiaires.
Sans doute un romancier était-il alors tenté, comme en France, de juxtaposer en de violents contrastes des discours de couleurs très différentes, le narrateur parlant la même langue châtiée que ses personnages, pourvu qu'ils soient instruits, et les illettrés y allant de leur sabir ou de leur patois. Sur ce point, Tolstoï ne le cède ni à Balzac ni à Zola. Mais il n'était pas impossible, si on le souhaitait, de se rappeler que la langue de plusieurs journaux, en Russie, n'avait pas toujours l'allure guindée qui caractérisait les revues françaises d'alors ; que, dans les meilleures familles, les maîtresses de maison prononçaient spontanément des phrases pittoresques et un peu bancales, comme on en entendait sur les lèvres de leurs nourrices. Imagine-t-on, chez Proust, la grand-mère du narrateur oubliant Mme de Sévigné et s'exprimant comme Françoise ? Françoise use pourtant d'un parler savoureux, admirable, que le narrateur reproduit avec affection et respect. Mais il y a un abîme que l'on ne franchit pas entre sa langue et celle de ses maîtres. Et mieux vaut ne rien dire de ce qu'on peut entendre ailleurs, dans la bouche d'autres domestiques : les guillemets ont un effet heureusement protecteur.
Des personnages inventés à partir de tics de parole
Dostoïevski ignore ces guillemets-là. Ce maître du dialogue invente ses personnages à partir de tics de parole. Il ne se préoccupe pas de leur faire illustrer le langage de la classe qu'ils représentent, et ce, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il attend d'eux des expressions, et non un style uniforme. La lecture de ses carnets est hautement instructive de ce point de vue. On dirait parfois qu'une phrase est notée avant même que l'auteur ait su le nom de son personnage et déterminé son statut social. Ensuite, l'intrigue des romans met en contact des milieux- très différents. Les héros empruntent des manières de parler à ceux qu'ils rencontrent.
Dans Les Démons, Stavroguine est l'inspirateur du meurtre de Chatov. Il l'a suggéré à Verkhovenski en termes, pour une fois, argotiques. Un traducteur ne pourrait pas ne pas employer le mot « zigouiller », ou tel autre de même affreuse couleur. On se rappelle que Stavroguine, cet aristocrate, a fréquenté, et fréquente toujours les pires fripouilles.
Comment se fait-il que le prince Mychkine soit l'ami de Rogojine ? Le prince, par moments, reprend à son propre compte la syntaxe un peu chaotique du fils de marchand. Traduire un discours de Rogojine comme si ce personnage était membre du Jockey Club constitue sans doute l'une des plus graves infidélités dont un traducteur puisse se rendre coupable. Aujourd'hui, les lecteurs ne sont plus disposés à l'admettre, pas même ceux qui souhaitent vivement que, à l'écrit et à l'oral, « pas » ou « jamais » soient précédés de « -ne ». Il en allait autrement au début du XXe siècle. Rogojine avait droit au beau langage, sans doute parce qu'il figure au premier rang parmi les dramatis personae.
On n'exagérerait pas beaucoup en soutenant que, chez les romanciers français d'autrefois, l'usage de parlers étrangers au bon usage avait une valeur pittoresque ; certains dialogues se transformaient en vitrines de musée. Par voie de conséquence, les personnages ainsi caractérisés étaient traités comme des comparses. Si le protagoniste manquait à parler Vaugelas, le lecteur se trouvait comme convié à lire un roman documentaire et, pour ainsi dire, entomologique. »
Au cours du siècle qui vient de s’écouler, il semble également que l’esprit du lectorat se soit considérablement ouvert. C'est du moins ce que soutiennent en 2014 Pauline Gacoin Lablanchy et Adèle Bastien-Thiry, dans leur article " André Markowicz et les enjeux de la retraduction " ( Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, lisible en bibliothèque sur cairn.info :
« Lors de la découverte tardive de Dostoïevski en France dans les années 1880, les premières traductions sont l’œuvre d’Élie Halpérine-Kaminsky et de Charles Morice, auxquelles viennent s’ajouter celles de J.-Wladimir Bienstock. Dans les années 1930, toute une nouvelle génération de traducteurs remplace ces pionniers : les travaux d’Henri Mongault, Albert Mousset, Vladimir Pozner, Doussia Ergaz, Louise Desormonts, Boris de Schloezer, Sylvie Luneau et Pierre Pascal constituent encore aujourd’hui la majeure partie des traductions de Dostoïevski disponibles en France au catalogue de Gallimard qui les a progressivement rachetées. En poche, l’éditeur propose encore des traductions qui datent des années 1930 ; à la Pléiade, on trouve surtout des versions retravaillées dans les années 1950, ainsi que quelques traductions des années 1970, effectuées par de nouveaux traducteurs, parmi lesquels il faut citer Lily Denis ou Gustave Aucouturier.
Sans jamais qualifier les traductions de ses prédécesseurs de mauvaises, André Markowicz leur reproche d’avoir francisé Dostoïevski en gommant les particularités de la langue russe peu familières au lecteur français. Ces critiques ne semblent pas dénuées de fondement si l’on considère les premières traductions. En effet, certaines spécificités des romans russes rencontraient à l’époque la vive désapprobation des critiques littéraires. Les traducteurs prenaient alors beaucoup de liberté par rapport au texte original, comme en témoigne l’initiative d’Élie Halpérine-Kaminsky et Charles Morice, n’hésitant pas à fusionner deux nouvelles de Dostoïevski, La logeuse et Mémoires écrits dans un souterrain, sous un titre de leur invention, L’esprit souterrain. Par ailleurs, le premier publia une partie des Frères Karamazov sous le titre Les précoces en 1889. En 1911, André Gide justifiait cette démarche en affirmant qu’à ses yeux, « le public n’était pas mur encore pour supporter une traduction intégrale d’un chef-d’œuvre aussi foisonnant. Cependant, avec le temps, la réflexion sur la manière de rendre plus fidèlement les spécificités stylistiques du russe dans la langue française est devenue une préoccupation majeure des traducteurs, parmi lesquels l’éminent slaviste Pierre Pascal qui, lui aussi, a traduit tout Dostoïevski.
L’accueil des traductions de Markowicz et la place de Dostoïevski en France
Markowicz a cherché à approfondir cette réflexion. Pour mettre en avant les différences entre syntaxe française et russe, il s’abstient de respecter les règles grammaticales de notre langue, néglige par exemple la concordance des temps et s’autorise aussi des fautes de grammaire. Ses choix, qui seront étudiés plus amplement dans un deuxième temps, ont été accueillis froidement. En 1993, le Centre national du livre hésite à apporter les subventions nécessaires à Actes Sud pour la traduction de L’idiot. Malgré certaines réticences, elles sont finalement accordées. Rapidement les critiques pleuvent. Dominique Fernandez avoue avoir abandonné la lecture au bout de cent pages : « J’avais l’impression de me retrouver face à une de ces versions latines que nous faisions au lycée », déclare-t-il. Jean-Louis Backès, quant à lui, est plus nuancé : « Je ne suis pas convaincu par tout, mais c’est bien comme ça qu’il faut traduire ». Le metteur en scène Antoine Vitez, qui a pourtant travaillé en collaboration avec Markowicz, reconnaît, lui aussi, avoir le sentiment que sa négligence de la grammaire française équivaut à de la sur-traduction. Les doutes persistent et, en 1995, le Centre national du livre refuse cette fois-ci d’accorder les subventions pour Les démons.
Comment expliquer la virulence des réactions ? André Markowicz évoque la rigidité de la langue française à laquelle il s’oppose : « La grande différence entre la littérature russe et française c’est qu’il existe ici une norme du bien écrire ». Mais il nous semble aussi pouvoir expliquer cette véhémence des réactions par la singularité du statut de Dostoïevski en France, une singularité perçue par Markowicz : « Le problème c’est que l’influence de Dostoïevski a été considérable sur toute la pensée française du début du xxe siècle. Donc toucher à Dostoïevski, c’est un peu comme toucher à Camus », dit-il. De fait, à la fin du xixe siècle, Dostoïevski est montré en exemple par un certain nombre de critiques s’opposant au naturalisme français. Après la guerre, il devient le maître incontesté de nombreux écrivains. André Gide, prié de dresser la liste de ses dix romans préférés, s’exclame même : « Qu’est-ce qu’un Balzac, face à un Dostoïevski ? ».
[…]
Plusieurs caractéristiques de l’écriture de Dostoïevski rendent ce travail particulièrement difficile. Il y a d’abord le problème de l’oralité : le russe est une langue où se distingue moins qu’en français la frontière entre l’écrit et l’oral. Markowicz la qualifie d’« émotionnelle » : ce qui est important dans la phrase russe est placé en premier. Il entend donc rendre sensible la syntaxe française à cette dimension. Les romans de Dostoïevski sont en outre habités par ce que Markowicz appelle « le souffle, l’âme du texte » qu’il entend faire ressentir en français. Bien loin d’une simple traduction littérale, il estime qu’il faut restituer le rythme de la phrase russe, au motif que forme et fond ne font qu’un, et qu’il n’y a ainsi pas à choisir entre les deux. Encore une fois c’est une interprétation qui se doit non d’être fidèle, mais cohérente.
André Markowicz relève en outre le pari de traduire jusqu’aux gestes, différents d’une langue à l’autre. On l’a compris, il veut tout traduire : le sens littéral, l’« intonation », comme ce qui n’est pas dit. Une seule chose est selon lui intraduisible, c’est l’histoire de la littérature. Il résume les choses ainsi :
« Un texte littéraire met en jeu des choses qui ne sont pas du niveau du sens littéral, mais des éléments liés à la civilisation, donc du niveau de la connotation. Il y a le rythme, la sensualité des choses. La littérature n’est pas une simple information, c’est ça qui est intéressant ».
Pour retranscrire le chaos qui selon lui règne en maître dans l’œuvre de Dostoïevski, Markowicz a pris un parti difficile à assumer en France, à savoir négliger la pureté de la langue française au profit d’un maniement plus brut, correspondant davantage à l’esprit du texte original. Ce n’est pourtant pas pour la maltraiter mais pour la réinventer, exploiter le plus possible ses possibilités et en faire une langue autre, nouvelle et non littéraire. Il fait valoir que si la littérature française est du côté de l’esthétique, pour Dostoïevski elle est d’abord de l’ordre de l’éthique. »
La traduction de Markowicz nous semble traduire plus intégralement les différentes dimensions de l’œuvre. Cela dit, une remarque : ses traductions se limitent aux romans et aux récits de Dostoïevski. Sa correspondance est traduite par Anne Coldefy-Faucard, quant au « Journal d’un écrivain », recueil de chroniques tenues de 1873 à 1881, on en trouve des traductions de Jean Chuzeville et Gustave Aucouturiez.
Bonne découverte !
Les différences notables entre les différentes traductions de Dostoïevski sont bien résumées dans un article de Marie-Christine Blais pour le journal canadien La Presse :
« Quand l'écrivain et traducteur André Markowicz décide de traduire à son tour Crime et châtiment de Dostoïevski en 1996, pour Actes Sud, sait-il qu'il va bouleverser le monde de la traduction littéraire? Jusque-là, c'est la traduction d'«école française» qui menait : on adaptait le texte dans une autre langue, mais en le tirant vers la culture de cette langue de traduction, quitte à embellir l'original ou à transformer le style de l'auteur, pour que la version soit plus fluide pour les lecteurs.
L'«école allemande» propose plutôt de respecter à la fois la langue et la culture d'origine du texte original, de ne pas chercher à «améliorer» le style de l'auteur, quitte à ce que le résultat soit moins élégant, l'élégance étant de toute façon une notion subjective. Les traductions de Markowicz «rendent» le style plus brutal, plus contemporain et moderne de Dostoïevski, près d'un siècle après la mort du grand auteur russe.
Version de Pierre Pascal (traduction à la française)
«Cette pauvre Élisabeth était à ce point simple, abattue et épouvantée une fois pour toutes que l'idée ne lui vint même pas de lever les bras pour défendre son visage, bien que ce fût le geste le plus naturel à cet instant, puisque la hache était levée droit sur sa tête. [...] Le coup tomba droit sur le crâne, du côté du tranchant, et coupa en deux toute la partie supérieure du front presque jusqu'au sommet du crâne. Elle s'écroula.»
Version d'André Markowicz (traduction à l'allemande)
«Et, cette malheureuse Lizaveta, elle était tellement simple, tellement écrasée, à tout jamais terrorisée, qu'elle ne leva même pas la main pour se protéger le visage, même si c'était là, à cet instant, le geste le plus naturel et le plus indispensable, parce que la hache était levée tout droit devant son visage. [...] Le coup lui arriva directement sur le crâne, avec le tranchant de la lame, et lui fendit tout de suite la partie supérieure du front, presque jusqu'au sommet. Elle s'effondra net.» »
Sans vouloir introduire une hiérarchie entre les traductions, on peut résumer ainsi la situation : choisir entre une traduction « à l’allemande » et une traduction « à la française » - autrement dit entre la traduction d’André Markowicz et toutes les précédentes – c’est choisir entre deux expériences : soit découvrir le texte de la façon la plus proche possible de celle d’un russophone, soit le découvrir comme l’ont découvert les lecteurs français de 1880 ou 1930. Un article de Jean-Louis Backès dans La Revue des deux mondes remarque :
« Que s'est-il passé au cours du XXe siècle ? Deux phénomènes sont à considérer. D'abord, des linguistes, non contents de prescrire le bon usage, ont étudié objectivement la pratique langagière des Français, de ceux qui parlent bien comme de ceux qui parlent mal. Certains d'entre eux ont conclu, non sans hyperbole peut-être, à l'existence de deux systèmes différents, distingués notamment par leur syntaxe. Par ailleurs, des écrivains ont donné asile, dans leurs livres, à la variante non académique du français, sans toujours se rendre compte qu'il n'était pas uniquement question de vocabulaire : il ne suffit pas d'enchâsser un mot vulgaire dans une phrase à la Bossuet ; et l'on peut fort bien transcrire le français tel qu'il se parle sans recourir à un seul mot vulgaire.
Cette évolution a-t-elle été favorable à Dostoïevski ? On peut répondre tranquillement par l'affirmative. On le peut, si l'on compare ce qu'était l'état du russe au XIXe siècle et celui du français à la même époque. Sans contredit, la situation actuelle de notre langue est plus proche de ce qu'était alors celle du russe. Dostoïevski est incontestablement l'un des écrivains qui ont joué le plus librement de cet instrument dont il disposait : une langue où aucune discontinuité rédhibitoire n'éloignait la langue académique des manières de parler considérées comme familières, voire populaires. Il était possible de glisser de l'une aux autres par une série infinie d'intermédiaires.
Sans doute un romancier était-il alors tenté, comme en France, de juxtaposer en de violents contrastes des discours de couleurs très différentes, le narrateur parlant la même langue châtiée que ses personnages, pourvu qu'ils soient instruits, et les illettrés y allant de leur sabir ou de leur patois. Sur ce point, Tolstoï ne le cède ni à Balzac ni à Zola. Mais il n'était pas impossible, si on le souhaitait, de se rappeler que la langue de plusieurs journaux, en Russie, n'avait pas toujours l'allure guindée qui caractérisait les revues françaises d'alors ; que, dans les meilleures familles, les maîtresses de maison prononçaient spontanément des phrases pittoresques et un peu bancales, comme on en entendait sur les lèvres de leurs nourrices. Imagine-t-on, chez Proust, la grand-mère du narrateur oubliant Mme de Sévigné et s'exprimant comme Françoise ? Françoise use pourtant d'un parler savoureux, admirable, que le narrateur reproduit avec affection et respect. Mais il y a un abîme que l'on ne franchit pas entre sa langue et celle de ses maîtres. Et mieux vaut ne rien dire de ce qu'on peut entendre ailleurs, dans la bouche d'autres domestiques : les guillemets ont un effet heureusement protecteur.
Des personnages inventés à partir de tics de parole
Dostoïevski ignore ces guillemets-là. Ce maître du dialogue invente ses personnages à partir de tics de parole. Il ne se préoccupe pas de leur faire illustrer le langage de la classe qu'ils représentent, et ce, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il attend d'eux des expressions, et non un style uniforme. La lecture de ses carnets est hautement instructive de ce point de vue. On dirait parfois qu'une phrase est notée avant même que l'auteur ait su le nom de son personnage et déterminé son statut social. Ensuite, l'intrigue des romans met en contact des milieux- très différents. Les héros empruntent des manières de parler à ceux qu'ils rencontrent.
Dans Les Démons, Stavroguine est l'inspirateur du meurtre de Chatov. Il l'a suggéré à Verkhovenski en termes, pour une fois, argotiques. Un traducteur ne pourrait pas ne pas employer le mot « zigouiller », ou tel autre de même affreuse couleur. On se rappelle que Stavroguine, cet aristocrate, a fréquenté, et fréquente toujours les pires fripouilles.
Comment se fait-il que le prince Mychkine soit l'ami de Rogojine ? Le prince, par moments, reprend à son propre compte la syntaxe un peu chaotique du fils de marchand. Traduire un discours de Rogojine comme si ce personnage était membre du Jockey Club constitue sans doute l'une des plus graves infidélités dont un traducteur puisse se rendre coupable. Aujourd'hui, les lecteurs ne sont plus disposés à l'admettre, pas même ceux qui souhaitent vivement que, à l'écrit et à l'oral, « pas » ou « jamais » soient précédés de « -ne ». Il en allait autrement au début du XXe siècle. Rogojine avait droit au beau langage, sans doute parce qu'il figure au premier rang parmi les dramatis personae.
On n'exagérerait pas beaucoup en soutenant que, chez les romanciers français d'autrefois, l'usage de parlers étrangers au bon usage avait une valeur pittoresque ; certains dialogues se transformaient en vitrines de musée. Par voie de conséquence, les personnages ainsi caractérisés étaient traités comme des comparses. Si le protagoniste manquait à parler Vaugelas, le lecteur se trouvait comme convié à lire un roman documentaire et, pour ainsi dire, entomologique. »
Au cours du siècle qui vient de s’écouler, il semble également que l’esprit du lectorat se soit considérablement ouvert. C'est du moins ce que soutiennent en 2014 Pauline Gacoin Lablanchy et Adèle Bastien-Thiry, dans leur article " André Markowicz et les enjeux de la retraduction " ( Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, lisible en bibliothèque sur cairn.info :
« Lors de la découverte tardive de Dostoïevski en France dans les années 1880, les premières traductions sont l’œuvre d’Élie Halpérine-Kaminsky et de Charles Morice, auxquelles viennent s’ajouter celles de J.-Wladimir Bienstock. Dans les années 1930, toute une nouvelle génération de traducteurs remplace ces pionniers : les travaux d’Henri Mongault, Albert Mousset, Vladimir Pozner, Doussia Ergaz, Louise Desormonts, Boris de Schloezer, Sylvie Luneau et Pierre Pascal constituent encore aujourd’hui la majeure partie des traductions de Dostoïevski disponibles en France au catalogue de Gallimard qui les a progressivement rachetées. En poche, l’éditeur propose encore des traductions qui datent des années 1930 ; à la Pléiade, on trouve surtout des versions retravaillées dans les années 1950, ainsi que quelques traductions des années 1970, effectuées par de nouveaux traducteurs, parmi lesquels il faut citer Lily Denis ou Gustave Aucouturier.
Sans jamais qualifier les traductions de ses prédécesseurs de mauvaises, André Markowicz leur reproche d’avoir francisé Dostoïevski en gommant les particularités de la langue russe peu familières au lecteur français. Ces critiques ne semblent pas dénuées de fondement si l’on considère les premières traductions. En effet, certaines spécificités des romans russes rencontraient à l’époque la vive désapprobation des critiques littéraires. Les traducteurs prenaient alors beaucoup de liberté par rapport au texte original, comme en témoigne l’initiative d’Élie Halpérine-Kaminsky et Charles Morice, n’hésitant pas à fusionner deux nouvelles de Dostoïevski, La logeuse et Mémoires écrits dans un souterrain, sous un titre de leur invention, L’esprit souterrain. Par ailleurs, le premier publia une partie des Frères Karamazov sous le titre Les précoces en 1889. En 1911, André Gide justifiait cette démarche en affirmant qu’à ses yeux, « le public n’était pas mur encore pour supporter une traduction intégrale d’un chef-d’œuvre aussi foisonnant. Cependant, avec le temps, la réflexion sur la manière de rendre plus fidèlement les spécificités stylistiques du russe dans la langue française est devenue une préoccupation majeure des traducteurs, parmi lesquels l’éminent slaviste Pierre Pascal qui, lui aussi, a traduit tout Dostoïevski.
L’accueil des traductions de Markowicz et la place de Dostoïevski en France
Markowicz a cherché à approfondir cette réflexion. Pour mettre en avant les différences entre syntaxe française et russe, il s’abstient de respecter les règles grammaticales de notre langue, néglige par exemple la concordance des temps et s’autorise aussi des fautes de grammaire. Ses choix, qui seront étudiés plus amplement dans un deuxième temps, ont été accueillis froidement. En 1993, le Centre national du livre hésite à apporter les subventions nécessaires à Actes Sud pour la traduction de L’idiot. Malgré certaines réticences, elles sont finalement accordées. Rapidement les critiques pleuvent. Dominique Fernandez avoue avoir abandonné la lecture au bout de cent pages : « J’avais l’impression de me retrouver face à une de ces versions latines que nous faisions au lycée », déclare-t-il. Jean-Louis Backès, quant à lui, est plus nuancé : « Je ne suis pas convaincu par tout, mais c’est bien comme ça qu’il faut traduire ». Le metteur en scène Antoine Vitez, qui a pourtant travaillé en collaboration avec Markowicz, reconnaît, lui aussi, avoir le sentiment que sa négligence de la grammaire française équivaut à de la sur-traduction. Les doutes persistent et, en 1995, le Centre national du livre refuse cette fois-ci d’accorder les subventions pour Les démons.
Comment expliquer la virulence des réactions ? André Markowicz évoque la rigidité de la langue française à laquelle il s’oppose : « La grande différence entre la littérature russe et française c’est qu’il existe ici une norme du bien écrire ». Mais il nous semble aussi pouvoir expliquer cette véhémence des réactions par la singularité du statut de Dostoïevski en France, une singularité perçue par Markowicz : « Le problème c’est que l’influence de Dostoïevski a été considérable sur toute la pensée française du début du xxe siècle. Donc toucher à Dostoïevski, c’est un peu comme toucher à Camus », dit-il. De fait, à la fin du xixe siècle, Dostoïevski est montré en exemple par un certain nombre de critiques s’opposant au naturalisme français. Après la guerre, il devient le maître incontesté de nombreux écrivains. André Gide, prié de dresser la liste de ses dix romans préférés, s’exclame même : « Qu’est-ce qu’un Balzac, face à un Dostoïevski ? ».
[…]
Plusieurs caractéristiques de l’écriture de Dostoïevski rendent ce travail particulièrement difficile. Il y a d’abord le problème de l’oralité : le russe est une langue où se distingue moins qu’en français la frontière entre l’écrit et l’oral. Markowicz la qualifie d’« émotionnelle » : ce qui est important dans la phrase russe est placé en premier. Il entend donc rendre sensible la syntaxe française à cette dimension. Les romans de Dostoïevski sont en outre habités par ce que Markowicz appelle « le souffle, l’âme du texte » qu’il entend faire ressentir en français. Bien loin d’une simple traduction littérale, il estime qu’il faut restituer le rythme de la phrase russe, au motif que forme et fond ne font qu’un, et qu’il n’y a ainsi pas à choisir entre les deux. Encore une fois c’est une interprétation qui se doit non d’être fidèle, mais cohérente.
André Markowicz relève en outre le pari de traduire jusqu’aux gestes, différents d’une langue à l’autre. On l’a compris, il veut tout traduire : le sens littéral, l’« intonation », comme ce qui n’est pas dit. Une seule chose est selon lui intraduisible, c’est l’histoire de la littérature. Il résume les choses ainsi :
« Un texte littéraire met en jeu des choses qui ne sont pas du niveau du sens littéral, mais des éléments liés à la civilisation, donc du niveau de la connotation. Il y a le rythme, la sensualité des choses. La littérature n’est pas une simple information, c’est ça qui est intéressant ».
Pour retranscrire le chaos qui selon lui règne en maître dans l’œuvre de Dostoïevski, Markowicz a pris un parti difficile à assumer en France, à savoir négliger la pureté de la langue française au profit d’un maniement plus brut, correspondant davantage à l’esprit du texte original. Ce n’est pourtant pas pour la maltraiter mais pour la réinventer, exploiter le plus possible ses possibilités et en faire une langue autre, nouvelle et non littéraire. Il fait valoir que si la littérature française est du côté de l’esthétique, pour Dostoïevski elle est d’abord de l’ordre de l’éthique. »
La traduction de Markowicz nous semble traduire plus intégralement les différentes dimensions de l’œuvre. Cela dit, une remarque : ses traductions se limitent aux romans et aux récits de Dostoïevski. Sa correspondance est traduite par Anne Coldefy-Faucard, quant au « Journal d’un écrivain », recueil de chroniques tenues de 1873 à 1881, on en trouve des traductions de Jean Chuzeville et Gustave Aucouturiez.
Bonne découverte !
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter




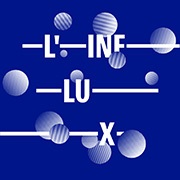 Béton : enquêtes en sables mouvants
Béton : enquêtes en sables mouvants