Question d'origine :
pourquoi les neutrons émis par une bombe à neutrons tuent-ils les êtres vivants?
Qu'est ce qu'une étoile à neutrons, et comment fonctionne ce genre de chose?
Réponse du Guichet
Le 16/12/2005 à 11h12
Vous pouvez consulter les réponses que nous avons déja élaborées à propos de la bombe atomique :
Comment se fabrique une bombe atomique ?
Quelle est la différence entre la bombe A et la bombe H ?
D'un point de vue militaire, la bombe à neutrons est dite "propre" comparée aux bombes A, H ou E. Sa conception a été optimisée afin de réduire les effets de l'explosion, en particulier la radioactivité, et augmenter énormément la quantité de neutrons libérés qui déclenchent la réaction en chaîne. Mais elle est plus mortelle qu'une bombe H !
En général l'énergie libérée par une arme nucléaire est emportée par l'onde de choc et le souffle (50%), la chaleur (35%), la radioactivité (14.7%) et le rayonnement électromagnétique (0.3%).
Une bombe à neutrons libère jusqu'à 80% de son énergie sous forme de neutrons rapides ! Leur rayonnement est amplifié grâce à la diminution du taux de réactions de fission vis-à-vis du taux de réactions de fusion. On y arrive généralement en éliminant l'uranium-238 qui joue un rôle modérateur. Cette réaction de fusion libère jusqu'à 6 fois plus de neutrons qu'une arme de pure fission ou de fission-fusion-fission; son niveau d'énergie par nucléon est d'environ 14 MeV, similaire à celui d'une réaction de fusion nucléaire.
Le rayon de la zone affectée par l'explosion augmente comme le cube de la puissance. Une bombe à neutrons de 1 kT peut libérer instantanément une dose létale de 80 gray (8000 rad) dans un rayon de 690 mètres alors que la zone affectée par le souffle est limitée à 550 m. Par comparaison, une bombe nucléaire de 10 kT présenterait le même rayon létal mais le souffle se ressentirait jusqu'à 1220 mètres.
Pourquoi augmenter l'émission de neutrons ?
Electriquement neutres, les neutrons interagissent peu avec la matière, mais ayant une masse voisine de celle du proton, ils interagissent très fortement avec ce dernier et principalement avec les tissus organiques constitués essentiellement d'eau.
La bombe à neutrons tue donc les êtres vivants tout en laissant les infrastructures et les armes intactes. Bien qu'il s'agisse d'une bombe thermonucléaire, c'est une bombe tactique par opposition aux armes stratégiques, car elle est construite de telle manière que le niveau de radiation devient insignifiant 48 heures après l'explosion.
Aujourd'hui, suite au démantèlement des armes nucléaires tactiques à l'échelle mondiale, ce genre de bombe ne doit plus exister dans les arsenaux.
(extrait de Les effets des explosions nucléaires, dossier du projet Luxorion.)
Pour en savoir plus , vous pouvez consulter sur le site du CEA (Commissariat à l'énergie atomique), les dossiers thématiques donnant une première approche pour comprendre l'atome, la radioactivité, l'énergie nucléaire ...
Et notamment le dossier intitulé L'homme et les rayonnements vous informera sur :
- la diversité des rayonnements
- les effets biologiques des rayonnements
- la radioprotection ...
Les étoiles à neutrons, qui sont parmi les corps les plus denses de l’Univers, sont les vestiges, les résidus d’étoiles mortes. Mais pas n’importe lesquelles … Seules les étoiles massives, de plus de 10 masses solaires, peuvent engendrer de telles monstres gravitationnels. Ce sont les physiciens Walter Baade et Fritz Zwicky qui, en 1934, prédirent l’existence d’étoiles entièrement constituées de neutrons et firent le rapprochement avec l’explosion des supernovae. En 1939, Oppenheimer et Volkoff1 développèrent avec plus de rigueur cette théorie des étoiles à neutrons.
Comment peuvent-elles « naître » à partir de la mort ? Il faut comprendre que dans l’Univers, tout n’est qu’une histoire de recyclage de la matière. L’étoile en fin de vie qui a consommé tout son carburant, nécessaire à la réaction thermonucléaire, se dilatera (géante rouge) puis s’effondrera sur elle-même, explosant enfin (uniquement pour les étoiles massives rappelons-le) en supernovae. Les couches externes gazeuses de l’étoile (dite nébuleuse planétaire) s’éparpilleront alors dans l’espace, entrant parfois en collision avec des nuages moléculaires et engendrant la formation d’une nouvelle génération d’étoiles. Reste le noyau de l’étoile …
Une étoile à neutrons possède un champ magnétique des milliards de fois supérieur à celui du Soleil. Cela s’explique par le fait que le produit de l’intensité du champ magnétique par la surface de l’étoile reste constant lors de l’effondrement stellaire. Du fait de la densité qui règne sur l’étoile, la force de gravité peut atteindre 1011 fois celle que nous subissons sur Terre et l’énergie unissant les neutrons atteint 10% de leur masse au repos (à titre de comparaison, le noyau d’hélium engendré dans la fournaise solaire lors de la fusion thermonucléaire possède une énergie de liaison de 0.7%) !
L’énergie ainsi libérée est alors de l’ordre de 100 MeV/nucléon, alors que l’énergie d’une réaction thermonucléaire de fusion ne libère qu’environ 8 MeV/nucléon …
Une telle énergie produite génère également des températures de plusieurs millions, voire milliards, de degrés. Une grande quantité de lumière est alors dégagée, pourtant invisible à l’œil nu car à ces températures l’étoile brille essentiellement en rayons X et gamma, également en ondes radio...
La quantité d’étoiles à neutrons est aujourd’hui estimée à environ 100 millions dans notre galaxie, soit une proportion d’une étoile à neutrons pour un peu plus de 1000 étoiles dites « classiques ». La plupart d’entre elles sont considérées comme « mortes », ne dissipant plus d’énergie, mais beaucoup sont encore actives et observables.
(extrait de Les étoiles à neutrons, les dossiers de l'astronomie.)
DANS NOS COLLECTIONS :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



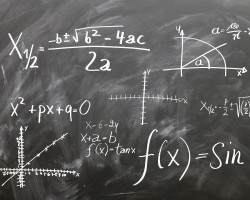
 Méditerranée
Méditerranée