Question d'origine :
Bonjour,
Je suis professeur stagiaire de lettres à l'iufm de lyon et dans le cadre de mon mémoire professionnel, je vais travailler avec mes élèves de seconde sur les brouillons.
J'aurai aimé une aide pour former ma bibliographie.
Je cherche des ouvrages (ou articles) qui traitent de l'apport de la réécriture mais surtout du rôle du brouillon pour les élèves dans leur "apprentissage" du bien écrire.
Merci d'avance,
claranouche
Réponse du Guichet
Le 17/12/2005 à 15h18
Le texte suivant devrait pouvoir vous aider dans votre recherche:
Les brouillons d'écoliers, Claudine Fabre
(version abrégée de la thèse d'Etat soutenue en 1987 à l'Université de Paris IV, 233 p).
« Le patient travail de linguiste fait par Claudine Fabre sur les brouillons d'écoliers met en évidence un savoir-faire que les élèves exercent en toute inconscience et comme de façon honteuse : celui de la réécriture. Ajouter, supprimer, remplacer, déplacer, voici donc les quatre gestes simples que chacun accomplit dans le cours de la production d'un texte.Pour notre plaisir, Claudine Fabre découvre leurs mécanismes et leurs difficultés.Le regard est celui d'un chercheur, neutre, précis, prudent. Psychologues, sociologues, linguistes, peuvent y trouver matière pour alimenter leurs propres réflexions.Quant à la recherche en didactique de l'écriture-lecture-réécriture, elle s'en trouve directement stimulée.Le brouillon étant le lieu où sont conservées les traces du débat interne à celui qui lit-écrit, il est en effet tentant de construire quelques séquences d'apprentissage développant la compétence métalinguistique des élèves.Sans aucun doute s'opère ainsi une avancée importante pour qui veut apprendre ce qu'à juste titre Claudine Fabre nomme "l'entrée dans l'écriture".Mais – et ce n'est pas le moindre de ses mérites – ce travail prépare aussi bien une entrée dans la littérature par l'écriture. »
Publication assurée par le CEDITEL et L'Atelier du texte,1990.
Ainsi qu'un article disponible sur les cahiers d'école.
Le titre suivant pourra éventuellement vous être utile, bien qu'il concerne plus spécifiquement l'autobiographie:
Les brouillons de soi, de Philippe Lejeune
Explore les coulisses de l'acte autobiographique, entre les brouillons et le texte final, en partant de l'influence des textes déjà lus, les doutes sur les souvenirs d'enfance, les rêveries sur les possibles inaccomplis et les tournants décisifs. Une étude menée à partir de trois "classiques" du récit de jeunesse : Les mots, de Sartre, Enfance, de N. Sarraute, Journal de A. Franck.
Vous pouvez également consulter, sur des problématiques plus littéraires, le catalogue de l'exposition "Brouillons d'écrivains" de la Bnf.
Cette exposition continue par ailleurs à être consultable en ligne.
Réponse du Guichet
Le 20/12/2005 à 08h47
En complément, voici une autre référence qui pourra également vous intéresser :
Réécrire à l'école et au collège : de l'analyse des brouillons à l'écriture accompagnée / Claudine Fabre-Cols (ESF éd., 2002)
(nous attirons votre attention sur la collection "Didactique du français" chez ESF éd., dont l’ouvrage ci-dessus fait partie. La BM de Lyon en possède plusieurs titres).
Nous vous suggérons également de consulter le catalogue de l’INRP (Institut national de recherche pédagogique). Notamment la banque de donnée DAF (Didactique et acquisition du français langue maternelle). Voici en particulier quelques références :
Contribution des brouillons à la connaissance de l'écriture scolaire, par Catherine Lamothe-Bore, in Le Français aujourd’hui (2004)
L'auteur a étudié un corpus de brouillons d'élèves recueilli dans des situations didactiques diverses (évaluation diagnostique de début d'année, élaboration de textes sur une durée d'un mois avec interventions de l'enseignant) et constitué de genres textuels divers (récit, compte-rendu, résumés de cours, 4ème de couverture). De cette analyse, elle dégage deux constantes dans l'écriture scolaire : les incertitudes énonciatives dans la position du sujet scripteur et l'effort constant de rationalisation pour se rapprocher d'une production conforme aux normes linguistiques et discursives. Les incertitudes énonciatives peuvent tenir au genre scolaire auquel l'élève est confronté, en particulier quand ce genre n'est pas vraiment normé : on le remarque dans les hésitations sur l'emploi de la première personne dans une synthèse de leçon ou dans la rédaction d'une 4ème de couverture. Les séances de dialogue avec le professeur et la classe peuvent, dans ce cas, permettre des réécritures attestant de choix énonciatifs cohérents et conscients. Dans le cas d'une écriture évaluative, on constate, à la lecture des brouillons, l'importance des modifications portant sur le signifiant graphique et l'effort de conformation aux normes linguistiques attendues. La réécriture favorise ainsi une rationalisation qui se manifeste dans le soin apporté aux liens de causalité. Elle favorise également la recherche ou la découverte de la stéréotypie, en particulier au plan générique. En fait, une correction, en apparence très localisée, peut faire bifurquer le texte d'un scénario stéréotypé à un autre. L'analyse des brouillons invite alors à s'interroger sur les normes que se donnent les enseignants pour lire et interpréter l'écriture scolaire.
Des brouillons de lecture - J'efface tout et je recommence, par Régine Delamotte-Legrand, in Repères (éd. INRP, 2001)
Cette contribution propose l'état de réflexion et de recueil de données d'une recherche en cours menée dans le laboratoire DYALANG. Elle concerne les manières dont les lecteurs ordinaires, en particulier les enfants qui sont en permanence confrontés aux pratiques scolaires de lecture , abordent l'acte de lire des ouvrages ou des textes hors de l'école. La pratique dont il s'agit ici n'est pas l'ensemble de la lecture, mais seulement ce que l'on pourrait appeler ses " brouillons ". En effet, comme l'acte d'écrire, l'acte de lire a aussi ses premiers jets, ses essais et erreurs, ses tâtonnements. Eloignées d'une pratique scolaire dominante de lecture, ces diverses versions d'une appropriation textuelle sont révélatrices de savoir-faire, de bricolage, de braconnage, de ruses et d'inventions (au sens de Michel de Certeau). Le travail présenté fait apparaître un certain nombre de ces pratiques à travers des entretiens avec des enfants et propose des pistes de recherche. (d'après l'abrégé du périodique)
Représentations du brouillon et apprentissage de l'écriture, par Marie-Claude Penloup, in La Français aujourd’hui (1994)
L'étude des brouillons d'écrivains, les écrits des généticiens du texte confirment la légitimité d'une exigence du brouillon à l'école. Mais le brouillon est-il enseigné clairement comme une compétence, est-il vécu ainsi par les élèves? Pour le savoir, l'auteur a mené une enquête auprès de 67 enseignants et de 142 enfants issus de 3 collèges de la région rouennaise, dont un en Zone d'éducation prioritaire. L'enquête fait apparaître une situation didactique floue où le brouillon est exigé mais rarement enseigné. De plus, cette situation paradoxale s'articule sur un doute quant au statut du brouillon, celui-ci étant perçu, par le scripteur apprenant, comme la preuve de son incompétence. Ce sont les caractéristiques mêmes de l'écriture qui ne seraient pas perçues. Pour lever ces ambiguïtés, l'auteur propose une séquence d'apprentissage autour des représentations du brouillon qui débutera par un questionnaire, moyen simple et rapide de faire émerger les représentations des élèves et qui se terminera par l'observation de manuscrits d'écrivains.
Enfin, voici quelques titres de revues spécialisées en pédagogie et didactique du français :
Cahiers pédagogiques
Le Français aujourd'hui
Revue française de pédagogie
Sciences de l'éducation
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter



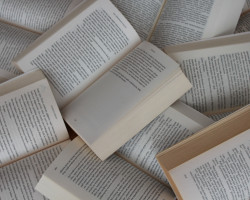
 Danseurs de cordes
Danseurs de cordes