Question d'origine :
Est-ce que les philosophes sont souvent en désaccord? Comment savoir qui a raison?
Réponse du Guichet
Accord, désaccord, le simple fait d'avoir des idées, des opinions, des ressentis différents n'est-il pas le processus, sans chercher à avoir raison, par lequel il faudrait passer pour aller vers l'harmonie ? Voici quelques notions et quelques pistes sur la raison.
Bonjour,
Vous le disiez vous-même dans votre question posée le 6 juin 2025, personne n'a trouvé la grande formule, la grande vérité, même les philosophes ne sont pas tous d'accord sur tout. Nous vous renvoyons donc à la réponse mais aussi à celles des questions Pourrait-il y avoir sans cesse des discussions, des débats sur tout ? et L'éthique et la morale sont-elles aussi sujettes à débats et désaccords philosophiques ?
Bien évidemment nos réponses restent ouvertes et ne font que vous proposer des pistes à explorer pour répondre à vos questionnements car, à l'instar des philosophes (même si nous ne sommes que bibliothécaires), nous ne détenons pas la vérité.
A votre question de ce jour, qui a raison ? voici une première piste, celle du chanteur Jérémy Frérot :
D'après nous, ces paroles nous disent que personne n'a raison et surtout que, ne pas chercher à avoir raison c'est rester libre. Intéressant le rapprochement entre ces deux concepts. La raison serait-elle donc la prison ? Cette question en amène une autre : qu'est-ce que la raison ?
La fiche de révision du bac La raison en philo de l'Etudiant en donne une définition, ses caractéristiques et différentes conceptions philosophiques :
Le terme raison provient du latin ratio qui signifie calcul ou raisonnement logique. Ainsi, la raison est cette force qui nous permet de procéder à des déductions rigoureuses et à des analyses rationnelles. La raison est avant tout une faculté de connaître qui nous permet d'analyser, de déduire et de comprendre le monde qui nous entoure. Elle se manifeste dans notre capacité à utiliser la logique, à évaluer des preuves et à utiliser des arguments cohérents. Ainsi, la raison est le propre de l’homme.
Qu’est-ce qui caractérise la raison ?
La raison peut être pensée sous différents angles :
Sous l'angle moral : ce qui est considéré comme raisonnable représente la raison.
Sur le plan cognitif : elle est équivalente à la rationalité ou à la capacité intellectuelle.
Dans une perspective plus générale, la raison désigne l'aptitude à penser de manière logique.
Quelles sont les différentes conceptions philosophiques de la raison ?
Plusieurs philosophes ont abordé le concept de raison, au premier rang desquels figurent Aristote, Descartes, Kant, mais aussi Nietzsche. Voyons leurs conceptions de cette notion de philosophie.
La raison selon Aristote
Pour Aristote, la raison (ou logos en grec) est une faculté distinctive de l'homme, qui le sépare des autres êtres vivants. Selon lui, elle est au cœur de la nature humaine et joue un rôle central dans sa capacité à penser, à comprendre et à discerner le vrai du faux, le bien du mal. La raison est ce qui permet à l'homme de vivre selon la vertu et de réaliser sa fonction propre (eudaimonia), qui est de vivre une vie conforme à la raison. La raison guide l'homme dans la recherche du juste milieu entre les excès, permettant ainsi de vivre en harmonie avec soi-même et avec la société.
Comment Descartes conçoit-il la raison ?
Soucieux de conférer à la philosophie la même rigueur qu’aux sciences et aux mathématiques, Descartes a eu l'idée d'utiliser un outil : celui du doute méthodique. Il a tout remis en question afin d'établir des vérités fiables et indiscutables en partant de connaissances dont il était impossible de douter. C'est grâce à cette démarche qu'il a trouvé sa première vérité : « Je pense donc je suis. »
La raison selon Kant
Pour aborder la question « Que suis-je en mesure de connaître ? », Kant réalise une analyse minutieuse des capacités et des limites de la raison. Dans sa philosophie, la raison est envisagée dans son acception la plus vaste comme englobant tout élément de la pensée qui est inné et ne découle pas des expériences vécues.
Selon Kant, la raison peut être :
Théorique (ou raison pure) ou encore spéculative, lorsqu'elle se rapporte au domaine de la connaissance.
Pratique (ou raison pratique), lorsqu'elle est envisagée sous l'angle de ses préceptes moraux (cette conception globale de la raison se différencie, selon Kant, de la définition plus restreinte de la raison en tant que capacité humaine).
Pourquoi Nietzsche critique-t-il la raison ?
Nietzsche avance que la raison est utilisée pour imposer des catégories rigides sur le monde, réprimant ainsi la diversité et la complexité de la vie. Il voit la raison comme un outil de domestication de l'humain, éloignant l'individu de ses instincts naturels et de sa puissance vitale. Cette critique s'inscrit dans son rejet plus large des valeurs traditionnelles et de la morale conventionnelle qu'il considère comme des construits sociaux entravant l'expression authentique de la force vitale, ou « volonté de puissance », qui anime chaque individu.
Philosophie magazine évoque quant à lui des philosophes du XXe siècle :
Du latin ratio, « calcul ». La raison est un mode de pensée qui permet à l’esprit humain d’organiser ses relations avec le réel. C’est, pour Aristote, la faculté distinctive de l’homme qu’il définit comme zoon logikon (« animal raisonnable »). Elle est la « puissance de bien juger et de distinguer le vrai d’avec le faux » pour Descartes, qui estime qu’elle est « naturellement égale en tous les hommes » et qu’elle est identifiable au « bon sens » ou à l’entendement. Pour Leibniz, qui parle à cet égard de « principe de raison suffisante », elle est la cause nécessaire de tout ce qui accède à l’existence. De son côté, Kant la définit comme la faculté des principes (et non des concepts qu’il réserve à l’entendement) : elle permet de spéculer sur les idées métaphysiques (comme l’âme ou Dieu) et de fonder la morale, la raison pure découvrant par elle-même qu’elle a une destination pratique. Considérée comme l’instrument par excellence du progrès durant le siècle des Lumières, la raison a néanmoins été critiquée au sein même des débats philosophiques dès le début du XIXe siècle par les romantiques qui lui opposent le sentiment, par Nietzsche, qui lui préfère le corps, ou encore par Bergson, qui valorise contre elle l’esprit. Au XXe siècle, les freudo-marxistes de l’École de Francfort estiment que la raison n’a pas tenu ses promesses d’émancipation. On parle aussi, depuis le XVIe siècle, de « raison d’État » pour dire que la politique a des intérêts propres qui justifient l’usage de moyens que la morale réprouve.
Du même magazine vous pourriez lire aussi Comment savoir quand on a raison ? ainsi que La « raison » dans la philosophie publié par La revue des ressources.
Nous vous conseillons également la lecture des articles de l'Encyclpédie Universalis RAISON (notions de base) par Philippe GRANAROLO, RAISON par Éric WEIL ainsi que celle de ces livres :
La raison / Bertrand Saint-Sernin, 2003
Propose une histoire de l'évolution de la notion de raison en philosophie de l'Antiquité à Whitehead.
L'articulation des raisons : introduction à l'inférentialisme / Robert Brandom ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Claudine Tiercelin et Jean-Pierre Cometti, 2009
Dans ce recueil d'essais, le philosophe américain expose sa conception inférentialiste du sens des mots et des concepts, sa théorie des normes et du raisonnement pratique, sa théorie de la connaissance, sa théorie sociale de la représentation et sa conception normative de la rationalité.
Le rationalisme est-il rationnel ? : l'homme de science et sa raison / Jean-Louis Léonhardt, 2008
Le modèle de la raison rationaliste proposé par Aristote a été adopté par le monde occidental. Mais l'invention des géométries non euclidiennes a ruiné le rationalisme. La rencontre de dualités dans notre perception du monde empirique impose un nouveau modèle de la raison. Désormais plusieurs théories concurrentes peuvent prétendre décrire une même portion du monde ; mais chacune d'elle doit admettre son incomplétude.
Critique de la raison pure / Emmanuel Kant
La "Critique de la raison pure de Kant" : 1959 / Theodor W. Adorno ; édité par Rolf Tiedemann ; traduit par Michèle Cohen-Halimi, 2024
Ce cours sur la Critique de la raison pure est à la fois une introduction à l'un des livres majeurs de Kant et le laboratoire de la Dialectique négative, oeuvre maîtresse de l'auteur publiée en 1966. Le philosophe remet en valeur la richesse du kantisme théorique en opposition à l'absolutisme d'Hegel, préparant sa thèse du primat de l'objet. © Electre 2024
Goodbye Kant ! : ce qu'il reste aujourd'hui de "La critique de la raison pure" / Maurizio Ferraris ; traduit de l'italien par Jean-Pierre Cometti ; préface de Pascal Engel, 2009
Une relecture de l'oeuvre de Kant qui vise à restaurer sa pensée en éliminant les apories et en pointant ce que l'auteur considère être des erreurs pour y apporter ses propres corrections.
Une métacritique de la "Critique de la raison pure" / Johann Gottfried Herder ; traduction, introduction et notes par Michel Espagne, 2022
Ami de Goethe, pasteur à Weimar et élève de Kant, Herder publie en 1799 cette critique de l'oeuvre de son maître. Inspiré à la fois par Leibniz et les philosophes britanniques, il dénonce aussi certains aspects de la pensée de Hegel et démontre que les concepts ne se construisent pas a priori mais résultent d'une interaction entre le sujet et les objets du monde. ©Electre
Une histoire de la raison : entretiens avec Émile Noël / François Châtelet ; préface de Jean-Toussaint Desanti, 2021
Une histoire de la raison Composante essentielle de la civilisation occidentale, la rationalité imprègne si bien tous nos modes de pensée que l'on en viendrait presque à oublier qu'elle a une histoire. A l'heure du triomphe de la raison technicienne, François Châtelet nous invite à une passionnante remontée aux sources. De Socrate à Platon, de Galilée à Machiavel et de Nietzsche à Freud, il retrace «l'invention de la raison», marque les grandes étapes de la pensée philosophique et montre – avec sa simplicité coutumière et un rare talent de conteur – comment se sont tissés d'indissolubles liens entre la liberté et la raison, même si cette dernière, conclut l'auteur, n'a pas encore atteint "l'âge de raison".
Etes-vous sûr d'avoir raison ? / Gilles Vervisch, 2022
Adaptée d'un spectacle, une promenade ludique en compagnie de Sartre, Schopenhauer ou Lévi-Strauss autour de la certitude d'avoir raison. © Electre 2022
L'énigme de la raison / Hugo Mercier et Dan Sperber ; traduit de l'anglais par Abel Gerschenfeld, 2021
Prenant le contre-pied de l'idée selon laquelle la raison aurait pour fonction première de permettre à chacun de parvenir par lui-même à une meilleure connaissance du monde et à des décisions plus justes, les auteurs expliquent que cette faculté est avant tout à usage social. Bien employée, elle aiderait surtout les humains à tirer le meilleur parti de leurs interactions et à agir collectivement. © Electre 2021
Bonne journée.



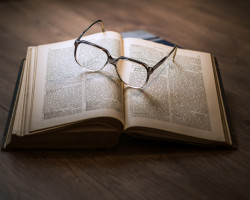
 Zones
Zones