Les valeurs morales sont-elles hiérarchisées différemment selon les groupes sociaux ?
Question d'origine :
Je suis désolé d'encore poser une question sur les valeurs; vos réponses m'aident beaucoup dans mes ruminations et je vous adore. J'ai posé une question en rapport avec les valeurs au niveau psychologique: les gens hierarchisent-ils aussi différemment les valeurs morales?: par exemple une personne pourrait accorder plus d'importance à l'honnêteté qu'à l'empathie alors qu'une autre personne pourrait trouver plus important de toujours dire la vérité même si cela blesse; une personne pourrait trouver le courage plus important que la bienveillance? Les gens hierarchisent-ils différemment les valeurs morales?
Réponse du Guichet
Oui, les valeurs morales sont relatives : elles varient selon les individus, les cultures et les époques. La psychologie et l’anthropologie montrent même que nos jugements du bien et du mal dépendent du contexte social, culturel et historique.
Bonjour,
Oui les valeurs morales sont relatives.
Nous vous remercions une fois encore pour la confiance que vous nous accordez et nous sommes très sensibles au bien-être que peuvent vous procurer nos réponses, d'autant plus si elles vous apprennent de nouvelles choses ! Mais comprenez, nous ne pouvons pas réécrire ou réalimenter continuellement la même réponse. Presque à la manière des Exercices de style de Raymond Queneau, le Guichet du savoir et chacun de collègues contributeurs de bibliothèque, ont tous exprimé, à leur manière avec leurs sources et leurs exemples, la grande relativité des valeurs (à échelle individuelle et collective avec parfois des revirement à l'échelle d'une, mais aussi plus largement sur le temps long historique) chez l'être humain.
Encore le mois dernier nous affirmions que les humains, dans leur extrême diversité, n'accordent pas tous la même importance aux choses. Parmi ces distinctions, les valeurs morales ne font pas exception à la règle. Le courage, l'altruisme, l’honnêteté et l'empathie ne sont pas appréciées de la même façon selon les individus ou les groupes sociaux. Cette distinction n'est même pas toujours consciente, elle peut aussi s'exprimer différemment selon les situations. Certaines personnes peuvent même ne pas partager précisément la même définition du courage ou de l'altruisme...
Voici donc ce que nous répondions à votre question le 17 octobre dernier : Avons-nous tous des priorités différentes ?
En psychologie, les valeurs [...] sont « des motivations trans-situationnelles, organisées hiérarchiquement, qui guident la vie ». Les valeurs sont considérées comme des variables latentes, qui ne sont pas directement observables mais qui se manifestent à partir de nos perceptions, nos attitudes, nos choix, nos comportements, nos jugements et nos actions. Dans ce sens, elles permettent de répondre à la question pourquoi agissons-nous comme nous agissons ? La psychologie des valeurs peut aider à comprendre ce qui est le plus important pour un individu (ou pour un groupe) et ceci à travers différents contextes et situations sociales.
source : Valeurs (psychologie)
Nous vous invitons à lire cet article de l'encyclopédie Wikipedia dans son intégralité pour en savoir plus. Vous verrez qu'il existe différents modèles d'après les psychologues (voir la partie intitulée "Les théories des valeurs").
Vous avez raison : les êtres humains n’accordent pas tous la même importance aux choses. Chacun adopte sa propre hiérarchie de valeurs dans son esprit. C’est ce qu’expliquent les théories modernes des valeurs motivationnelles : pour certains, la bienveillance ou la famille prime ; pour d’autres, la réussite, le pouvoir ou la séduction occuperont le sommet de la hiérarchie. Ces priorités peuvent se réorganiser au fil du temps selon le contexte de vie.
Les modèles de Shalom Schwartz, Milton Rokeach et Geert Hofstede figurent parmi les approches les plus influentes de la psychologie et de la sociologie des valeurs. Chacun d’eux conçoit la hiérarchie des valeurs humaines sous un angle différent : personnel, universel ou culturel.
A votre question : La morale est-elle différente selon les personnes ? (2023), nous revenions sur l'histoire du relativisme culturel, en passant par le texte fondateur de Montaigne "Des cannibales" et la naissance de la science anthropologique, avec au fond une question centrale : le bien et le mal sont-ils des valeurs absolues ?
Nous avions conclu que la morale, "ancrée dans notre nature biologique [...] contribue à la survie des individus [...] en particulier en favorisant les comportements coopératifs" tout en étant "en perpétuelle interaction avec la culture dans laquelle les individus se développent et interagissent" - et que "Chaque individu répond et réagit à un ensemble de valeurs, héritées ou construites qui guident sa vie. Ce sont des principes partagés par la société dans laquelle il évolue qui lui indiquent ce qui est juste, désirable ou important."
Qu'il y ait une diversité de conceptions de ce qui est bien et de ce qui est mal, c'est une évidence. Le même acte peut être vu comme bien ou mal selon les idées de la personne qui le regarde : cela hante de grands débats comme celui sur l'avortement, mais des événements comme les Grandes Découvertes peuvent être vues par certains comme un bienfait pour la connaissance du monde ou comme une catastrophe au regard des civilisations détruites et des millions de morts provoquées... tous ces points de vue différents sont liés à l'histoire des cultures, des idées, des religions...
C'est vers le XVIè siècle que l'occident commence à accepter l'idée qu'on puisse penser autrement ailleurs. Dans son essai "Des Cannibales", Montaigne s'oppose à l'horreur provoquée chez ses contemporains par certains rites sud-américains, montrant que ce qui est mal vu ici peut être bien considéré ailleurs
L’enjeu des guerres cannibales est tout moral et n’a rien à voir avec l’accaparement de quelque bien matériel que ce soit : terres productives que les Amérindiens n’ont pas à labourer, richesses qu’ils ne possèdent pas, corps impropres à tout autre exercice que la chasse, la danse ou la guerre. Les Cannibales ne font pas d’esclaves, et s’il leur arrive de transgresser des limites naturelles, c’est pour retourner, une fois la victoire obtenue, « à leur pays, où ils n’ont faute d’aucune chose nécessaire ».
Source : BnF
C'est ainsi que naît une nouvelle science : l'anthropologie, dont le relativisme culturel est un des fondements :
Dans le cadre de leur quête d'objectivité scientifique, les anthropologues actuels préconisent généralement le relativisme culturel, principe qui s'impose à toutes les sous-disciplines de l'anthropologie. Selon ce principe, les cultures ne doivent pas être jugées en fonction des valeurs ou des points de vue de l'observateur extérieur, mais examinées sans passion selon leurs propres termes. Il ne devrait y avoir aucune notion, en bonne anthropologie, d'une culture meilleure ou pire qu'une autre culture.
Nous vous invitons également à lire cet article d'Antonin Carrier et Anthony Lantian, chercheurs et maîtres de conférence en psychologie et psychologie sociale : Contre l’avortement, le mariage gay et les brocolis : pourquoi nos convictions morales sont-elles si spéciales ?. Les auteurs formulent assez simplement des réponses aux questionnements qui vous taraudent. Notamment pourquoi le bien et le mal sont érigés en valeurs absolues, et comment ces notions permettent à l'homme de vivre en société en se reposant sur des valeurs communes. Extraits :
1. L’absolu est rassurant
Nous avons besoin de donner un ordre et une structure à nos représentations du monde afin de lui donner du sens. Évoluer dans un monde imprévisible et chaotique est hautement anxiogène (Vess et al., 2009). Selon certains chercheurs, donner au bien et au mal la même permanence et la même stabilité que les vérités éternelles est une façon de projeter une structure simple, stable et rassurante sur le monde.
(...)
2. L’absolu permet de réguler les relations sociales
Il existe un consensus très large entre les philosophes, les biologistes, les anthropologues et les psychologues sur l’importance de la moralité dans la vie en communauté. Les principes moraux sont des règles de comportements partagées qui permettent à tout un chacun de savoir reconnaître le bien et le mal, le juste et l’injuste et donc de s’orienter dans le monde social (Haidt, 2001 ; Rai & Fiske, 2011 ; Tooby & Cosmides, 2010). Mais pourquoi ces principes moraux auraient-ils besoin d’être perçus comme étant absolus et objectifs pour assurer la coordination sociale ? Après tout, d’autres mécanismes relatifs ou subjectifs peuvent tout aussi bien remplir ce rôle. Prenons par exemple les préférences personnelles. Il va sans dire que nous préférons les gens honnêtes et généreux aux gens malhonnêtes et égoïstes. Si tout le monde se fiait à ses préférences personnelles, les gens ne seraient-ils pas découragés de se comporter de manière indésirable, par peur d’être mis à l’écart ? Pas si sûr. Il persistera toujours une marge de liberté que certains exploiteront pour jouer un double jeu et se présenter sous leur meilleur jour tout en profitant des autres. Et surtout, sans point de repère absolu, comment se mettre d’accord sur ce que signifie « se comporter de manière indésirable » ? Un monde dans lequel chacun possède sa propre définition de ce qui est désirable ou indésirable ne serait-il pas un monde dans lequel chacun voudra imposer ses préférences à tous les autres ?
Il semble donc nécessaire d’avoir des règles communes afin de ne pas faire sombrer la société dans une guerre de tous contre tous. Pourquoi alors les conventions sociales (p. ex. règles de bienséance, code de la route) qui, comme la morale, régulent de manière collective nos comportements en société, ne suffisent-elles pas à assurer la coordination sociale ? Parce que nous les percevons comme arbitraires, dépendantes de la culture ou de l’époque (Turiel, 1983). Nous avons bien sûr de très bonnes raisons de les respecter, mais ces raisons sont essentiellement « externes » : respecter les conventions sociales nous permet de répondre aux attentes du groupe ou d’une autorité établie, de préserver notre réputation, d’éviter la sanction ou l’exclusion, etc. Nous les respectons pour toutes ces raisons, mais est-ce que nous y adhérons intérieurement ? Pas si sûr. Après tout, en l’absence de ces raisons externes, pourquoi irions-nous mettre notre fourchette à gauche de notre assiette ?
Parcourez ces anciennes réponses pour approfondir vos réflexions :
- Est-ce que tout le monde a des valeurs personnelles ?
- Est-ce que notre comportement et nos valeurs sont subjectifs ?
- Est-ce que tout le monde a un code moral personnel ?
- Que veut dire "avoir des valeurs" ?
- Est-ce que tous les groupes sociaux ont leur propre code de comportement ?
Et pour aller plus loin :
- La morale humaine et les sciences / Sous la direction de Alberto Masala, Jérôme Ravat
- Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale / sous la dir. de Monique Canto-Sperber
- Psychologie du jugement moral : textes fondamentaux et concept / Laurent Bègue, Laurent Bachler, Catherine Blatier
- La question morale : une anthologie critique / Didier Fassin, Samuel Lézé
- NUROCK Vanessa, « Chapitre III. Les limites de la naturalisation de la morale : Pour une naturalisation modérée de l’éthique », dans : , Sommes-nous naturellement moraux ?sous la direction de NUROCK Vanessa. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Fondements de la politique », 2011, p. 97-142.
- BOURDIN, Jean-Claude. Naturaliser la morale ? In : Philosophies de la nature [en ligne]. Paris : Éditions de la Sorbonne, 2000
Bonne journée.



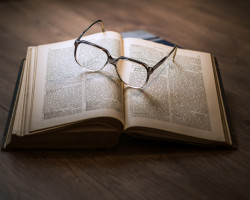
 French Theory
French Theory